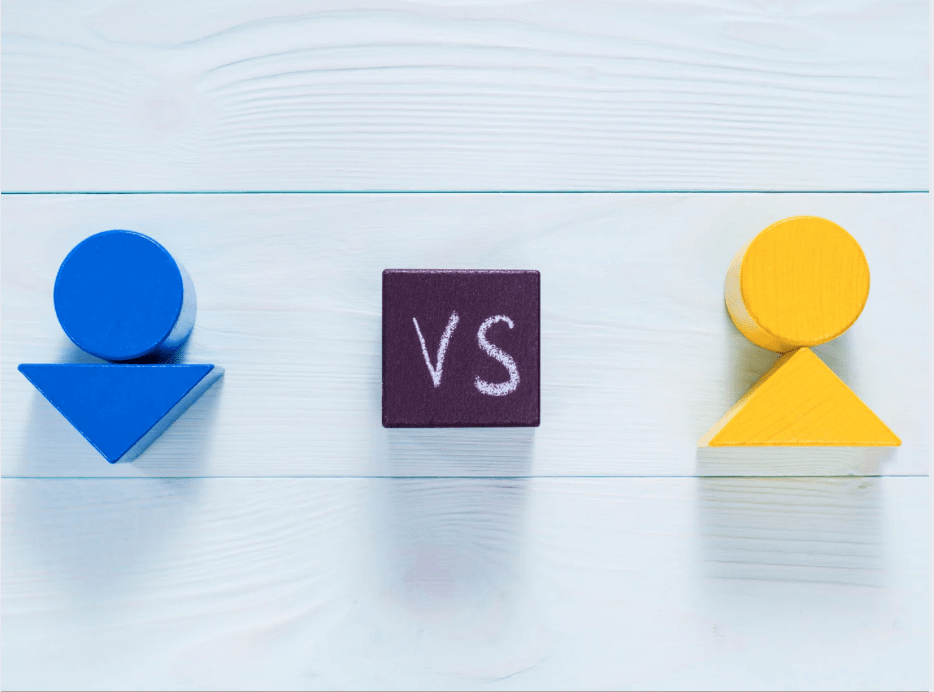Et si la vraie résilience, c’était aussi savoir dire : “là, j’ai besoin d’une pause” ? De plus en plus, on se demande si la résilience n’est pas devenue le nouveau mot pour justifier l’épuisement. Qu’on se comprenne bien : la résilience est une qualité extrêmement précieuse. Mais jusqu’à quel point peut-on la porter avant qu’elle devienne un fardeau plutôt qu’une force?
Ce texte n’a pas pour but d’apporter des solutions toutes faites. Il cherche plutôt à ouvrir une réflexion sur la ligne parfois invisible entre ténacité et suradaptation.
Une performance qui cache l’épuisement
Dans plusieurs milieux de travail, la ligne entre performance et épuisement devient de plus en plus floue. Ce n’est pas parce qu’on est performant qu’on va bien. Les deux peuvent coexister…jusqu’à ce qu’elle explose.
Selon l’American Psychological Association, la résilience c’est la capacité à « rebondir après des évènements difficiles ». Mais dans bien des contextes, on ne rebondit plus. On avance, épuisé·e, sans jamais vraiment récupérer.
Pourquoi on en parle autant maintenant
Si ce sujet résonne autant aujourd’hui, ce n’est pas un hasard. On sort d’une période marquée par une accumulation de bouleversements : pandémie, réorganisations constantes, surcharge de travail, pénurie de personnel, pression de performance, insécurité économique, etc. Et dans tout ça, le mot “résilience” est revenu comme un mantra.
On nous a répété qu’il fallait s’adapter, rebondir, rester calme, avancer malgré tout. On a admiré celles et ceux qui tenaient bon, qui continuaient sans se plaindre, en gardant une attitude « positive ». Mais à force d’être utilisée partout, l’idée de résilience a fini par s’user. Elle est devenue une attente silencieuse : « Sois résilient·e, mais vite. Et surtout, sans déranger ». “Be resilient, quickly. And preferably without making noise.”
Fatigue fonctionnelle : quand on tient debout…sans aller bien
Le plus trompeur dans tout ça ? C’est qu’on peut être performant·e, tout en s’éteignant à petit feu. On continue à livrer, à cocher les cases, à être “présent·e”, mais on ne récupère plus.
Par exemple, on se réveille plus fatigué·e qu’on s’est couché·e. On enchaîne les journées sans réelle pause, même le soir ou le week-end. On répond aux courriels en mangeant, on assiste à des réunions sans y être vraiment présent·e mentalement, on oublie des détails simples, ou on perd patience plus facilement avec les collègues ou les proches.
Et pourtant, sur papier, tout semble « normal » : on livre les projets à temps, on est à l’heure aux rencontres, on ne se plaint pas. C’est cette dissonance, entre ce qui paraît et ce qu’on ressent, qui rend la fatigue fonctionnelle aussi trompeuse.
On devient expert·e dans l’art de faire “comme si” : comme si tout allait bien, comme si on avait l’énergie, comme si c’était normal de ne jamais décrocher.
Cette forme de résilience, silencieuse, constante, épuisante, est valorisée dans bien des environnements, mais elle nous mène droit à l’essoufflement. Le corps envoie des signes. La tête aussi. Mais comme la performance est là, on se convainc que ce n’est « pas si grave ». Jusqu’au moment où tout lâche.
Et si le problème était culturel?
Si autant de personnes vivent aujourd’hui cette fatigue de fond, ce n’est pas uniquement à cause de leurs habitudes personnelles. Il faut aussi regarder le contexte de travail dans lequel elles évoluent.
Dans plusieurs milieux, la performance est devenue une valeur absolue. On valorise la rapidité, la disponibilité, la capacité à « gérer la pression ». Mais on oublie trop souvent de s’interroger sur le coût humain.
Dans certaines équipes, répondre à des courriels à 22 h est perçu comme un signe d’engagement. Prendre une vraie pause dîner peut être vu comme un luxe. Refuser une tâche supplémentaire, même avec une charge déjà pleine, peut être interprété comme un manque de motivation. Ce sont des exemples concrets d’une culture qui valorise la disponibilité constante plus que la santé réelle des gens.
Et parfois, même les initiatives de bien-être au travail comme les séances de méditation ou les webinaires sur la gestion du stress deviennent des outils de plus à intégrer dans une journée déjà trop remplie. On finit par se sentir coupable de ne pas avoir le temps de prendre soin de soi. Et la résilience, dans tout ça, devient parfois un outil de productivité déguisé. Un·e employé·e résilient·e, ce serait quelqu’un qui ne montre pas de faiblesse, qui s’adapte à tout, qui continue même quand c’est déraisonnable. Mais est-ce vraiment ça, la santé au travail ? Est-ce qu’on ne confond pas force et suradaptation? Et surtout : qui a le droit, aujourd’hui, de dire “je suis fatigué·e” sans craindre d’être jugé·e, mis·e de côté ou vu·e comme moins engagé·e ?
5 pistes pour préserver son équilibre
La résilience ne devrait pas être une obligation silencieuse, mais une capacité à rebondir avec du soutien.
Voici quelques pistes, pas magiques, mais profondément nécessaires, pour protéger son énergie.
1.Reconnaître les signaux d’alerte
La fatigue n’arrive pas toujours d’un coup. Elle s’installe doucement, souvent dans les détails : sommeil moins réparateur, irritabilité, perte d’enthousiasme, difficulté de concentration. Prendre le temps de s’écouter vraiment, sans minimiser, sans se dire “ça va passer”, est souvent le premier geste de prévention.
- 2. Redonner de la valeur à l’arrêt
On a appris à performer. À gérer. À livrer. Mais on a parfois oublié comment s’arrêter.
Faire une pause n’est pas un aveu de faiblesse, c’est une stratégie durable à long terme.
Même les machines ont besoin d’entretien. Pourquoi pas nous ?
Even machines need maintenance. Why not us?
- 3. Oser demander du soutien
Parler de sa fatigue, de ses limites ou de son besoin d’aide ne devrait pas être tabou. Que ce soit avec un·e collègue, un·e gestionnaire ou un·e professionnel·le, le soutien est une ressource, pas un luxe. Ces discussions, quand elles deviennent la norme, renforcent la sécurité psychologique.
- 4. Réviser ses propres standards
Being committed doesn’t mean being available 24/7.
Être engagé·e ne veut pas dire être disponible 24/7.
Souvent, c’est notre propre exigence envers nous-mêmes qui nous épuise.
Revoir nos attentes, apprendre à faire “assez bien”, à dire non, à poser des limites, c’est aussi de la maturité professionnelle.
- 5. Créer de vraies pauses
Pas juste scroller entre deux réunions. Des pauses qui régénèrent vraiment : marcher, respirer, s’étirer, décrocher vraiment. L’idée, ce n’est pas de tout arrêter. C’est de créer un rythme sain. Un espace pour que l’énergie circule, au lieu de s’épuiser.
Redéfinir la résilience au travail : vers un modèle plus durable
La vraie résilience ne devrait pas ressembler à un sprint sans fin.
Elle devrait ressembler à un mouvement fluide : avancer, s’arrêter, respirer, repartir.
Prendre soin de soi, c’est aussi une façon de prendre soin de son travail. Parce qu’un esprit clair, un corps reposé et une énergie préservée sont les fondations d’une performance durable et surtout, d’une vie qui a du sens.
Alors, la prochaine fois que tu sens que tu tiens bon, mais que la corde est sur le point de casser, rappelle-toi : savoir s’arrêter, c’est aussi une forme de force.
Source : American Psychological Association, apa.org apa.org